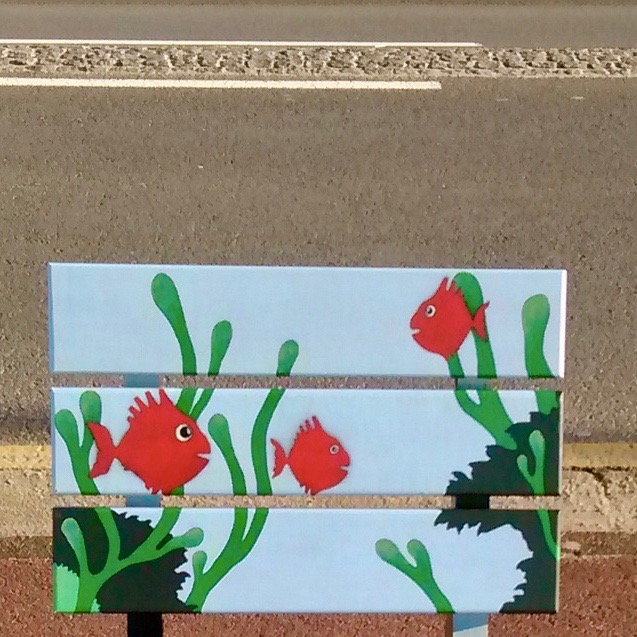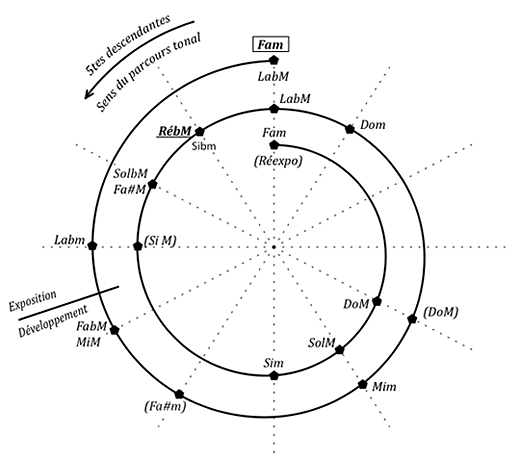j’hésite entre deux phrases,
j’hésite entre deux phrases,
ensuite, j’hésite quant à la manière de dire comment j’hésite,
il me semble que cette manière-ci ressemble à une ancienne phrase,
je ne veux pas vérifier, mais je suis presque sûre,
je prends alors une autre direction, je me mets en mode S (sport),
je peux passer les vitesses (le moteur vrombit dans les lacets, etc.)
\\\\\\\\\\\\\\\\///////////////
cette viduité superposée à celle de l’été,
je ne l’ai pas complètement inventée, seulement un peu transformée,
il semble que j’aie cessé d’hésiter entre deux phrases,
que décidément j’aie choisi l’une au détriment de l’autre,
pourquoi ? parce qu’elle était faible (ou qu’elle émouvait ?),
parce que j’hésitais encore sur la manière d’agencer ses constituants ?
je n’exclus pas le mot griffée par exemple,
je n’exclus pas le mot ronce, pourtant je n’ai pas choisi cette phrase-là :
la chair griffée par la ronce,
une chair fragile, d’un sein, la nuit,
lorsque la ronce griffe sous la lune pleine,
griffe, agrippe la rondeur blanche de la chair aussi blanche que la lune
////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\
sur la page, venues ensemble, l’une cependant plus petite que l’autre,
mais ensemble, posées, imparfaites, sans aucun rapport,
restées ensemble plusieurs jours et plusieurs nuits,
les deux phrases indécidables (mains jointes derrière le dos),
dans l’attente du sort qui leur serait fait, ont observé leur délai,
et rien ne s’est passé comme prévu, mais rien ne l’avait été, non plus
C’est un peu comme si l’on posait au-dessus d’un trou vide, par compensation, une coupole vide ;
comme la viduité sublime n’est que l’agrandissement de la viduité ordinaire,
il est en fin de compte bien naturel qu’à une époque où l’on vénère les personnalités succède une époque
où l’on tourne carrément le dos à tout ce qui sent la grandeur et la responsabilité.
Robert Musil, L’homme sans qualités