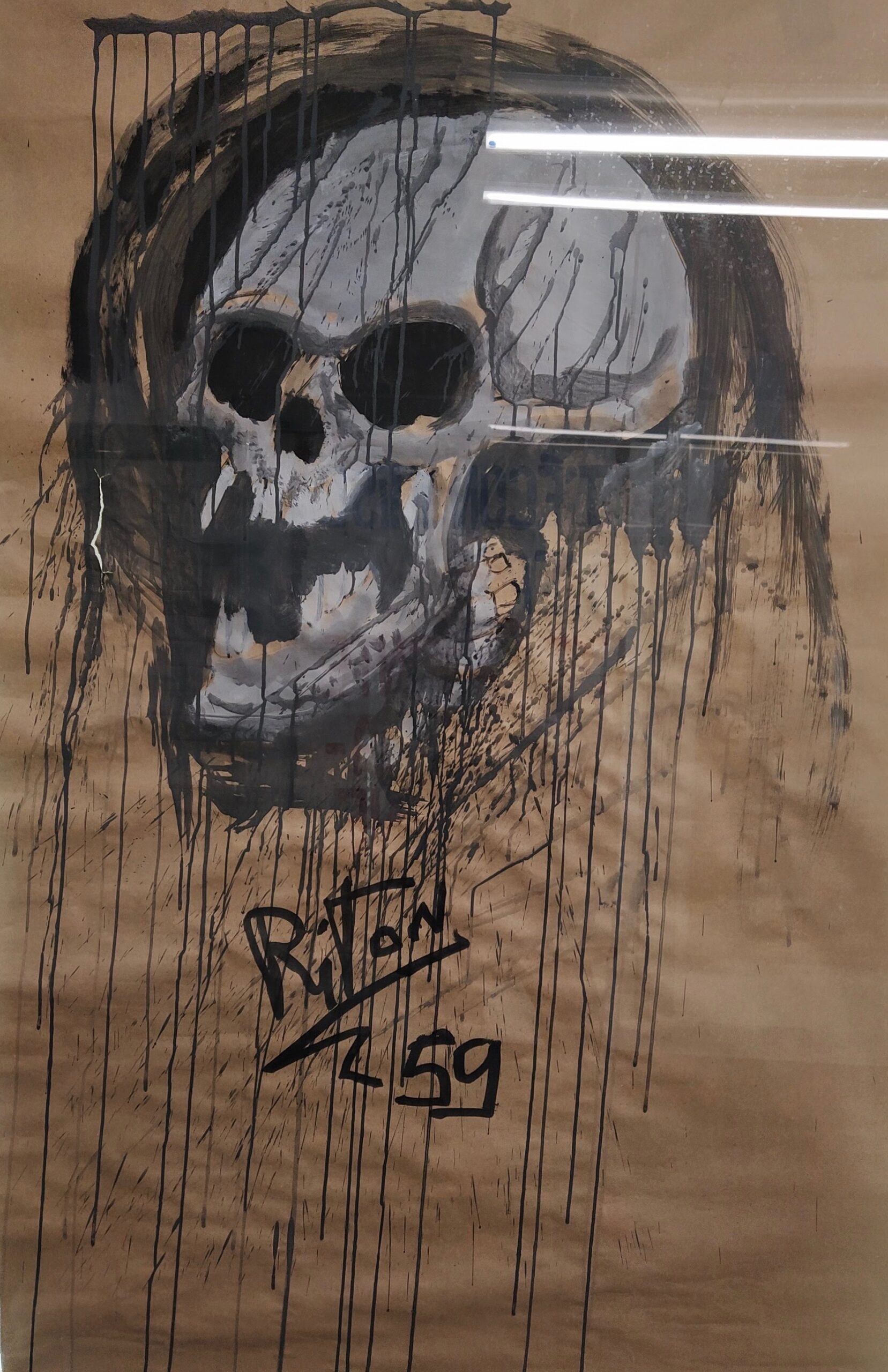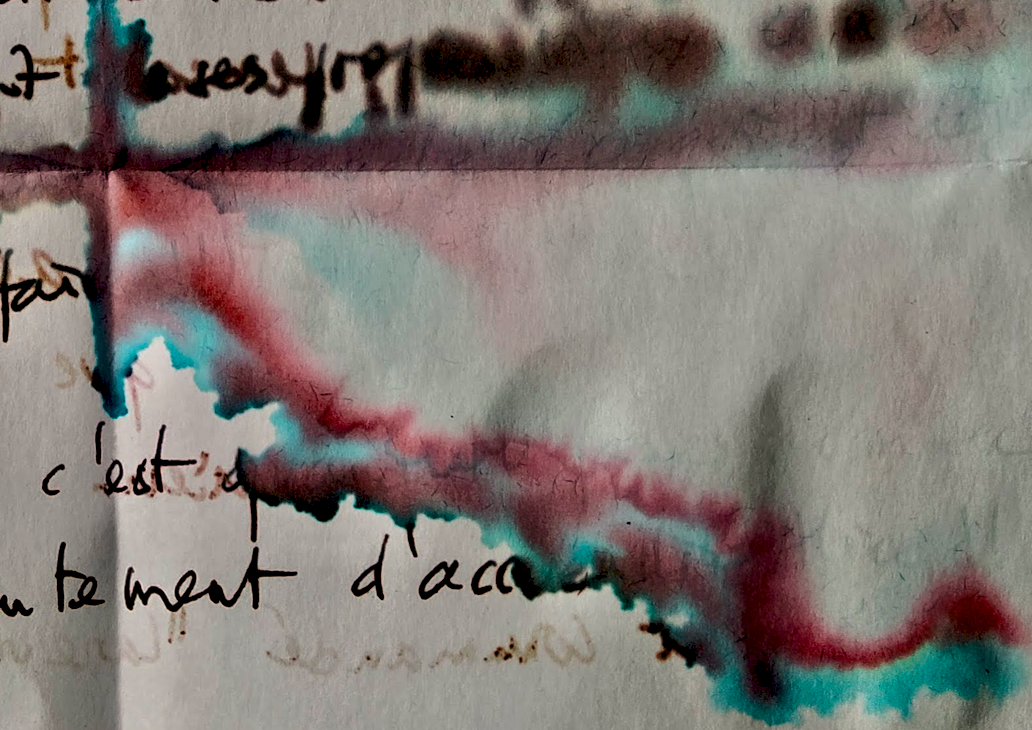texte exhumé des profondeurs par un ami lecteur, à haute voix
– écrit le 16 novembre 2002 –
La deuxième guerre est loin. Rien n’est plus nécessaire. Si je cherche ce qui est nécessaire, absolument nécessaire, je dois me rendre à l’évidence : rien ne l’est plus.
On dit encore la deuxième guerre, et pourtant c’est si loin. On a changé de siècle. C’était il y a une éternité : le froid, la collaboration, la neige. Il y eut beaucoup de neige durant l’occupation. Et des cris de poule, je n’y peux rien, oui, des cris de poule. Et des communistes.
Vue du XXIe siècle, la deuxième guerre, celle où il fallait mettre les majuscules :
1, les a perdues ;
2, a rendu tout très banal, la paix notamment.
La paix d’en haut, la paix du ciel chargé de nuages, couvercle bas de la brume brouillée, la paix du chaud et de la soupe, la paix des braves (encore des majuscules disparues). Je ne me ferais pas l’avocat de ces heures sombres, ni de la voix douce des infirmières qui servent à calmer les douleurs des blessés. Nous n’avons pas été blessés, à notre corps défendant. Point. Soyez froid et droit. Dormez bien, claque la porte et s’en va, remuant du popotin : à demain. Ah. Soupir flou du troufion.
La Grande Guerre à majuscules, depuis le 11 novembre 2002, nous en fêtons les derniers debout. Il risque de ne plus y avoir de couture au coin du feu ni reprisage de chaussettes avec l’oeuf en bois brut, ni. Nous attendons avec fièvre autre chose, nous ne savons pas quoi. Ce peut être glissant. Certaines choses ne reviendront plus, ne seront plus. C’est définitif. Certains vous disent : ah. D’autres : c’est l’enfance, ha ha ha, vous ne la reverrez pas de sitôt. Mais ne les croyez pas, ou croyez les, peu importe. Dépêchons-nous, accélérons, ne perdons pas de temps, vite, grouillons-nous, allez, magnez-vous, roulez devant.
Photographie à l’argentique, un instant d’éblouissement, les guêtres et leurs boutons étincelants, le rosissement des joues de la bonne, c’est fini, être uni pour la vie, le meilleur et le pire, la pièce montée, éblouissement, éblouissement.
De vieux enregistrements tournés à la manivelle et crachotants disques, grosses galettes, et l’aiguille, énorme, qui les raye, en fait surgir le son éraillé, grésillant. Chant des partisans. Perte de majuscules encore. Je regarde ceci comme derrière une palissade particulièrement hérissée d’échardes, et très gondolée. Ce siècle derrière a des odeurs de foin, je me demande bien pourquoi. Et de Grand Meaulnes.
Une douce voix de femme à châle vieux rose, comme il y en a partout dès l’évocation de la guerre, ouvre la porte à un type rustaud à moustaches, comme ils en ont tous eues, de l’autre côté de la palissade. Puis le ton monte, puis la femme gifle le type. On a beau être au courant, c’est toujours assez agréable et fameux, comme la soupe qui mitonne sur le fourneau, cet attendu de la scène domestique supposément éternel qui n’existe plus nulle part.
On ne verra plus cela, plus jamais. Enfin, qui l’a déjà vu, qui l’a jamais vu, qui l’a cependant vu, qui l’a parfois vu, qui l’a absolument ?…
Il s’agit de répéter ce qui est répétable, dans la limite où ça l’est, avec une grande économie de moyens, des gestes de plus en plus resserrés, des mots de plus en plus indigents, des dispositifs scéniques de plus en plus elliptiques.
De l’autre côté de la palissade, vous avez le chien, par exemple, prenons cet exemple. Il hurle à la mort, ou bien s’envoie un kilo de viande fraîche derrière le gousset (c’est un gros chien). Il attend son maître, car les choses sont en ordre. Le maître a entretemps rencontré la villageoise qu’il préfère, celle à qui il donne son linge à laver peut-être, l’a lutinée, un peu, puis s’en est venu s’occuper du chien. A force de persévérance, un jour, ils auront un voire deux enfant(s).
Ce n’est pas suffisamment pertinent. Il y faut aussi de l’accordéon et quelques morceaux de crépon au vent du crépuscule, une maison et du crépi beige. Parce qu’il ne fallait pas s’attirer les foudres de certains dieux anciens, ou récents, les mariés sacrifiaient à quelques rituels, dont celui du seuil de la maison patricienne. Soigneusement étudiés par les savants de l’après-guerre, qui n’avaient plus grand-chose d’autre à faire qu’à s’entre-regarder, ceux-ci rendirent peu à peu tous leurs secrets. N’ayant plus de secrets, ils n’avaient plus de raison d’être. Ils disparurent donc. On cessa non seulement les rituels, mais aussi de se marier. Non, il ne fallait plus regarder en arrière. De toutes façons, la palissade nous bouchait l’accès au rétroviseur du temps.
La jonquille se cueillait à une certaine saison. Généralement accompagnée de cris d’oiseaux spécifiques, elle se ployait gracieusement, émettait un petit cri de souffrance et prenait sagement place dans un bouquet champêtre. Au même tempo, mais pas à la même saison, vous avez le champignon. Etc. Le catalogue des choses trouvables telles que dans la nature existe quelque part derrière la palissade, www.nature.org. Il est bon de s’y référer pour la confection de l’omelette aux cèpes (partie recettes de Nanou). Ne pas s’y laisser prendre cependant. Ne se laisser prendre en général à rien.
Aller aux champignons comme aller cueillir des jonquilles revenait à passer du temps, à se baisser par intermittences près de la terre, la sentir au passage (recommandé par les meilleurs auteurs), et échanger des considérations plus ou moins banales, si possible le plus. C’était furieusement mode, bien que le mot s’appliquât à une toute autre réalité à l’époque : aller chercher de quoi améliorer son ordinaire. Toutes sortes d’autres choses étaient également trouvables, comme nous l’avons dit, oui, des choses triviales et accommodables.
Le plaisir était entier, immense, palpable. De ce plaisir, nous en avons des preuves, des millions de cartes postales collectionnées par des millions de collectionneurs qui ne savent pas pourquoi ils les gardent, pourquoi ils ne s’en séparent pas, écrites ou vierges, et qui parfois les échangent fébrilement au cours d’une rencontre de collectionneurs.
Ceci a aussi été observé. Parfois jusqu’à la tombée de la nuit.