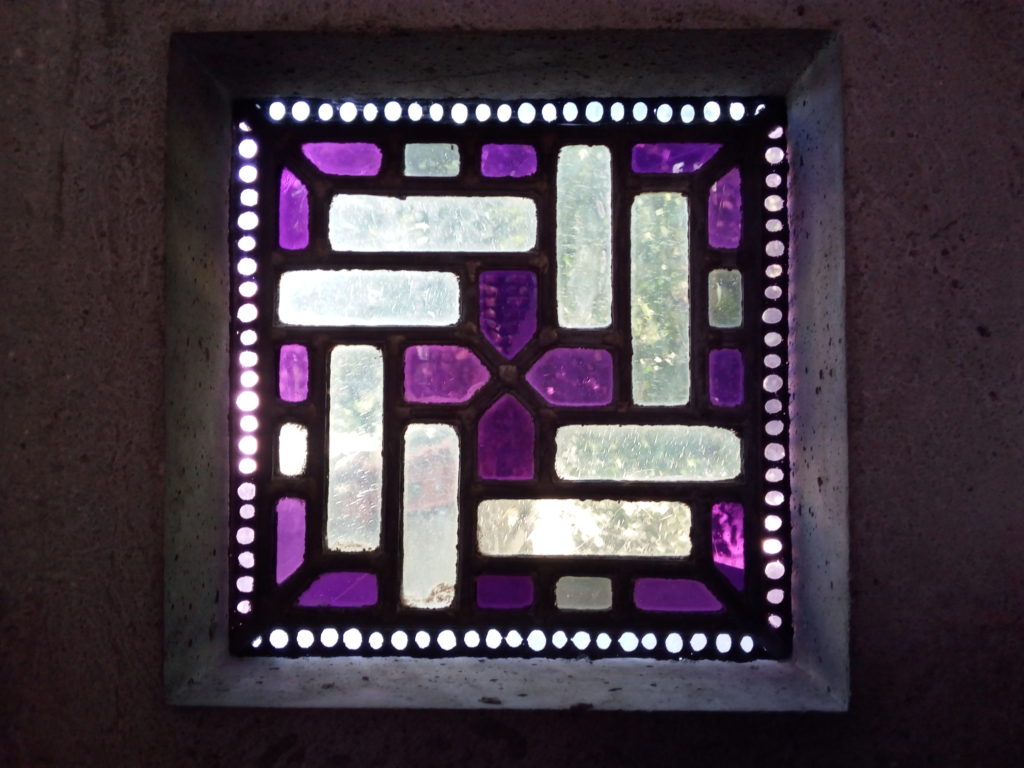[Un « en cours de lecture » retrouvé : lumineux, inspiré, érudit,
qui me fut adressé avant la parution du livre, par Philippe Rahmy]
Trois phrases par lesquelles j’ai fusionné avec l’écriture, après y être entré (touchant au projet d’écrire après avoir été touché par l’écriture) :
1.« Jasper est cet enfant se regardant être un enfant. »
2. « Jasper aimerait bien reparler avec Clemence Valenti, en savoir davantage sur elle, pour cela il doit faire l’effort de l’inventer, comment pourrait-il réellement, et serait-elle là, à l’attendre, c’est absurde, comment ? »
3. « Le va-et-vient naturel de Jasper avec le monde […] »
= = = = = = = = = =
Notes en cours de lecture :
Hoboken. Sur l’autre rive, Hoboken. Wikipedia dit qu’il existe un mémorial en projet à Hoboken, mémorial du 11 septembre 2001, une trace du/au futur ? et la ville de naissance de Frank Sinatra ?
Magnifique description du temps élastique des joueurs d’échecs.
Il suffit de montrer la possibilité de Jasper, pour que Jasper existe. Mais tout est effacé avant d’avoir débuté. Cet anéantissement comme naissance. La durée de cette naissance, comme une enfance. Comme Jasper. New York, l’Amérique, le monde stupéfié qui balbutie des pistes, des possibles, sachant qu’elles peuvent être effacées, et, pire, oubliées, car désormais, après la catastrophe, tous les trajets sont hypothèses, même le chemin le plus court entre Ground Zero et le musée, tout est et sera perpétuellement remis en cause par l’effet incessant des causes imprévisibles. Chaque parole peut être déparlée. Ces causes, on perçoit leur action, leur présence : dans le bruit, la vitesse.
Une catastrophe inédite. Formuler le sans-nom, ne pas le formuler, lui donner corps, naître de ça.
Il suffirait pourtant de montrer, comme la liseuse à la fenêtre, comme le tableau de Fromentin, de montrer la catastrophe. Impossible. Alors montrer l’impossible. L’aporie-Jasper.
Le jeu récurrent entre les interstices, les écarts, les isotopies disant la séparation, et l’isotopie contraire/complémentaire de la fusion : l’eau, les ponts, le désir d’Europe, la croissance, l’âge adulte, etc. (questionnement du temps qui hésite entre temps du devenir et temps éternel). Le liant (« ce qui manque ») est décrit comme « éclair », il peut être perçu par Jasper dans les yeux liquides de Clemence, de Clemence comme son autre, ou dans l’image de la « farine pulvérisée » (cendres–> « Der Tod ist ein Meister aus Deutschland »–> « tes cheveux de cendre
Sulamith »–>Celan–> la catastrophe inédite, naître de/après la Shoah).En Europe, matrice de la catastrophe, première et indépassable catastrophe. Regarder l’Europe, regarder le carnage de la Shoah. Le voir se refléter dans le miroir des tours de NY. Comment ? Impossible superposition. Pourtant écho. Naître « après ça »…
Le dessin de l’autiste survolant Manhattan réaliserait le prodige du monde réunifié ? La réparation « cicatricielle » du pêcheur sur le ponton, cet instant, soudain, donné comme épiphanie (cf. C. Simon, temps suspendu, éternité du monde fracturé, pourtant expérience d’une complétude).
Les automates, le mouvement saccadé, entre vitesse et immobilité ; projet héraclitéen d’appariement des contraires : le geste saccadé réalise, à sa manière, la fusion/suture/appariement entre le délié, le monde a-problématique, l’idylle d’avant la catastrophe, l’impensable « avant » et l’anéanti, le présent informulable.
Du pouvoir de la fiction. Le remède dans le mal ? Starobinski/Rousseau : Jasper, ou la fiction au chevet de l’Histoire. Du pouvoir de l’image… il suffirait de montrer (pourtant, sur le ponton, à côté du pêcheur, contemplant la perfection de cette image, Jasper se sait à côté de l’image, séparé). Le monde recousu demeure fracturé par son extérieur, par le regard.
La passion des visages chez Jasper. « Il n’en a jamais fini avec les visages » -> Levinas et les visages : le visage, antidote à la destruction, humanité.
De « l’abîme des profondeurs aquatiques » à la lumière des visages, au visage des victimes, au visage de « Clemence ».Vieille Europe et jeune Amérique autour du jeu d’échecs. Rapport crypté au monde, un langage de survivants (Perec), distinguant Clemence et Jasper : ils se parlent et ce sont des possibles qui se répondent, d’infinies listes de situations, de noms, de visages pétrifiés, d’innombrables vivants et d’innombrables victimes qui se regardent en silence, quand ces deux-là se parlent et s’inventent ; on serait alors avec « L’enfant fini », on ne le quitterait plus jamais, prolongeant la partie, la plainte et la joie, l’enfant infini multipliant les fugues et les spirales, comme un enfant fractal accordant encore une chance à la vie au moyen du langage.
[Le livre est toujours commandable chez l’éditeur]