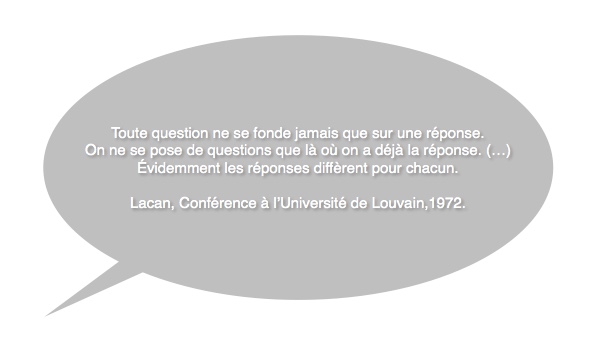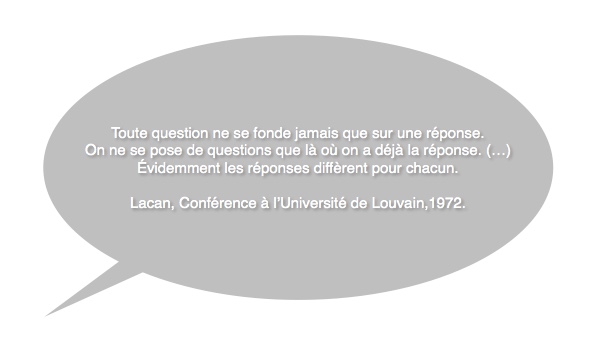1
C’est notre affaire de séparer les choses, dit L.
Séparer les choses ? dit U.
Disposées comme un décor, une nature morte ou une vanité,
les choses ne sont pas assoiffées de lien. Seul le regard porte le lien, dit L.
Il faudrait s’en défaire ? demande U.
Je ne sais pas ce qu’il faudrait, répond L.
Nous tenons quelque chose de minuscule, dit U.
devant le planisphère punaisé au mur de la cuisine.
………………………………………………………
2
Personne ne s’intéresse, dit L., l’Afrique, l’Orient, l’Asie, c’est si grand.
Je rectifie : nous ne tenons rien, dit U.
Tu as sommeil ? dit L.
Oui mais j’ai pas le temps, dit U.
Nous nous tenons comme minuscules, dit L.
C’est ça, nous nous. Nous sommes des sortes d’insectes, dit U.
Oui, mais nous ne connaissons pas leurs noms, il y en des milliards, dit L.
Des milliards d’espèces ! reprend U.
Ce n’est pas intéressant non plus la nature, dit L.
Non plus, dit U.
Ça fait combien de temps qu’on est devant ce planisphère ? demande L.
Trois ou quatre ans qu’on est dans cette cuisine à parler devant le planisphère, non ?
C’est toi qui l’as voulu, dit U.
Oui mais quelle autre solution ? dit L.
En effet, je ne sais pas, dit U.
Moi aussi je me sens seul, il n’y a pas d’issue.
………………………………………………………
3
Je dis ce que je pense, dit L.
On ne dit jamais ce qu’on pense, dit U., c’est impossible.
Et puis ça monte, et puis ça descend, dit L.
Des montagnes et des lacs, propose U.
On ferait quand même des phrases ? demande L.
Avec des imparfaits du subjonctif, dit U., il en faut.
Qui sait ce qu’il faut ? demande L.
Nous ne devrions pas nous poser la question, dit U.
Nous ne sommes que questions, dit L.
C’est un peu présomptueux, dit U.
………………………………………………………
4
C’est comme une absence, dit L.
C’en est une, dit U. Même pas comme.
Comme, ce serait si tu voyais autre chose, et alors tu dirais : par exemple.
Elle est là, mais c’est une absence : n’est pas là, dit L.
N’est pas là : un peu pauvre, non ? dit U.
Oui, mais j’ai pas les moyens de mieux, dit L.
Par exemple était l’affaire d’un très vieil homme, dit U.
Tu le connaissais ? demande L.
Oui et non, je l’entendais dire par exemple,
mais jamais pour donner un exemple, dit U.
L’exemple ne se donne pas ? demande L.
Dès que l’exemple surgit, il ne l’est plus ! C’est de la magie, dit U.
Tu dis par exemple et tu fixes la chose ? demande L.
C’est ça, dit U.
…………………………………………………………
5
À tel mot, il manque la dernière lettre, dit L.
Tu compliques toujours tout, dit U.
Il manque réellement la dernière lettre, dit L., mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ce n’est pas comme tout compliquer.
Tu me fatigues, dit U.
Regarde : si tu prends LHOO et qu’il manque le Q, ça ne veut rien dire, dit L.
C’est pas toi qui décides si quelque chose veut dire ou pas, dit U.
Parfois je ne connais que les noms, parfois que les musiques, dit L.
Tu ne fais aucun effort, dit U.
Non, aucun, dit L. J’aimerais connaître les noms quand je connais les musiques, mais c’est impossible, je ne retiens rien, j’entends la musique, j’en connais chaque note, je dirige mentalement l’orchestre, je sais ce que chaque partie doit faire,
mais impossible de dire le nom.
C’est pourtant simple, dit U.
Oui, parce que toi tu classes, tu retiens, dit L.
Ça se fait tout seul. En fait, c’est pas seulement la dernière lettre qui te manque,
c’est carrément le nom ? poursuit U.
Pas mal de noms, admet L.
Alors c’est pas la peine de me faire croire qu’il s’agit de la dernière lettre, dit U.
……………………………………………………
6
Reprenons l’exemple, dit L.
Oui ? demande U.
Ça m’intrigue, cette fixation, dit L.
Il faut que tu te concentres un peu, L., dit U.
Je fais tout pour mais tout part très vite, dit L.
Je te remercie de ta magnanimité.
Tu peux, dit U.
Je suis victime d’un éparpillement permanent de la pensée, dit L.
L’exemple est donné pour tel mais se transforme en réalité tangible immédiatement. Au lieu d’un morceau de discours qui laisserait penser qu’il y a une suite,
il devient cette suite-même, dit U.
Il y a substitution ? demande L.
Exactement, dit U.
Mais c’est encore plus subtil : au moment où l’exemple est prononcé,
il vient en lieu et place de la chose-même qui ne peut pas se dire.
Comment pourrais-je mieux t’expliquer ?
C’est un arrangement ? demande L.
En quelque sorte, mais pas voulu, dit U.
Mais à quoi ça sert ? dit L.
À adoucir le dire : si on donne l’exemple comme exemple, il paraît plus inoffensif que si on dit la chose-même directement, précise U.
Mais pourquoi ne pas dire la chose-même directement ? demande L.
Tu es fatigante, dit U.
……………………………………………………
7
J’ai eu ce grand élan, dit L.
Tu veux dire ? demande U.
avec une intonation plus affirmative qu’interrogative.
Tu fais souvent ça, observe L.
Quoi, ça ? Peux-tu être plus précise ? demande U.
Poser une question comme si tu ne la posais pas, dit L.
Quel grand élan ? reprend U.
Je ne sais pas…ce grand élan d’y aller, ce grand élan de me décoller de moi,
ça y est, j’y vais, dit L.
T’envoler ? dit U.
Un peu, pas exactement…me déployer plutôt, dit L.
Comme un oiseau, dit U.
On en revient toujours là : à être un oiseau mental, dit L.
Chaque métaphore est pauvre, faite du même métal, dit U.
Un acier de mauvaise qualité, dit L.
Un truc qui rouille dans un coin de hangar, dit U.
Mais je l’ai eu, ce grand élan : je suis allée de l’autre côté du lac, dit L.
Et ? demande U.
……………………………………………………
8
Il ne pouvait pas répondre, ça lui était impossible, dit L.
On se cultive, on se cultive, dit U.
Il n’avait pas le langage, il n’avait rien, il était un médiocre, un rien, dit L.
Mais de qui tu parles ? dit U.
Peu importe de qui, ils sont des quantités industrielles, ils pullulent, dit L.
Il y a une relative facilité, de ta part, à opérer ce genre de généralités, dit U.
Alors que quoi, dit L.
Tu opères, c’est tout, dit U.
………………………………………………………
9
Le silence, l’exil, la ruse, dit L.
James Joyce, dit U.
C’est bien, tu connais les noms, tout de suite, tu as les noms, dit L.
On se cultive, on se cultive, répète U.
Tu plaisantes, mais tu sais, dit L.
J’ai de la mémoire, dit U.,
c’est tout, c’est vraiment tout, un peu de mémoire.
Que fait-on avec ce monde, dit L. en caressant le planisphère.
Avec ou de ce monde ? demande U.
………………………………………………………
10
Est-ce qu’une réponse est une solution ? demande L.
Tu veux quoi ? demande U.
Je ne crois plus à rien, dit L.
Arrête ton char, dit U.