L’homme dort avec le chien.
La jeune fille photographie le chien venu mettre sa tête contre celle de l’homme.
Le chien est noir et blanc, de la race de Clément Houellebecq.
Un peu du bruit de la circulation routière se fait entendre.
Des enfants parlent néerlandais dans l’eau du lac.
Une grosse dame coiffée d’une casquette verte vient considérer l’homme allongé dans l’herbe.
Le chien noir et blanc a rejoint ses propriétaires flamands.
La jeune fille a rejoint la tablée voisine de celle du chien.
L’eau du lac est opalescente.
Le chien vaque d’une table à l’autre.
Il lappe volontiers l’eau du lac.
la couleur réglisse des mots
[19 juillet 2014]
j’ai les trois premiers mots, ils sont venus ce matin suite à un rêve compliqué, je les mâchonne déjà un certain temps pour être sûre qu’ils ne se font pas la malle, puis je sombre dans une tristesse sans fond dont par définition j’ignore l’origine et d’ailleurs si j’en connaissais l’origine qu’est-ce que ça changerait, ensuite je les promène, eux et la tristesse, plus l’extrême chaleur, pour tenter de diluer le tout, ça se transforme en mayonnaise informe dans une grande librairie dont je tais le nom puisque de librairie elle n’a plus que l’intitulé, lequel n’est pas identique au nom, je suis dans un cauchemar, tout a disparu, je veux dire, tous les livres, autant dire tout, ne reste que des images très colorées, stupides, des touristes trop grands, des effigies, des gilets pare-balles, du bleu-blanc-rouge,

et alors je veux disparaître dans une tente mais je suis retenue au bord de la disparition par l’idée, toute con, de la popote ; la popote, cet objet qui flirte avec la tente ; par l’idée, toute con, de l’oreiller gonflable ; l’oreiller gonflable, cet objet mou qui flirterait avec mon cou, mais comment ; le mobilier de camping ; ces objets tout cons qui flirtent avec le néant de l’horaire ; et, alors qu’une G réparatrice, entendre ici bière irlandaise très brune, me répare, les trois premiers mots sont toujours là, maintenant très éloignés comme un train très en retard, je les maintiens, les saucissonne, les arraisonne, sans aucune certitude sur leur ordination, et leur demande des comptes : vous, là, les trois premiers mots, oui, vous /
quelque chose est signé à la place
elle lit les mots n’y sont pas
quelque chose est signé à la place
un pré avec deux ânes dedans
à sa frontière se courbe la route
les ânes viennent sous les mots
une femme longe des céramiques
collées sur une façade grise
que des rails prolongent de leurs mots
le rapprochement de la femme et des ânes
imminent teinte l’espace de mots
un marbrier contigu expose
des plaques gravées de lettres
elle lit les mots n’y sont pas
un flottement de noir&blanc

ce flottement, d’abord apparu sur un banc, n’était pas encore noir&blanc
portant des bretelles violettes, un homme lent au journal caché paraissait hésiter
une femme réfléchissait assise devant un mur troué d’une porte verte écaillée
plus tard, B. lui dit d’écrire, dans un léger rire que des bruits de sirènes ponctuaient
un homme rangeait ses journaux plus tôt que d’habitude, il souffrait des dents
le flottement, identique à celui des ans, nimbait de vieilles vitrines inchangées
quand le temps indolent s’étalait, la femme achetait le journal, celui-ci, le même
de noir&blanc le flottement consistait à l’endroit précis où se tenaient les assis
assises sans objet
je vais me lever
je vais me laver
c’est tralala :: c’est peu
c’est peu mais c’est beaucoup
c’est déjà demain pourtant
c’est la guerre on combat jusqu’à la mort
les hommes aiment la mort aiment la mer
ils aiment tant et tant regarder la mer et mourir
tant et tant les mots, tant et tant Momò
je me lève et me lave
tant de fanfares, tant de phares et de gares

il n’y a plus de port usb
les sièges sont douillets
plein d’horizons nouveaux
la stratégie est très claire : je me lave après
je me lève d’abord
puis je prends les destinations
l’adresse mythique plaît à Momò, il la loue
il sera heureux dedans l’adresse
il créera des petits boutons et se lavera
il est trop tard, il y a trop d’écho
il faut penser au long-terme
aux petits oiseaux
aux reines-claudes
à l’aller simple pour la mort
les grandes prairies
les grandes prairies
—————————
doivent être écrites
les grandes prairies
seraient une dame
mince et fragile
déjà âgée et un sourire
ils ont tenu un tabac-presse
puis un bar-brasserie
la dame aime peindre
mais ne peint plus
sa mère est morte
les grandes prairies
s’étagent sous le regard
son mari lui dit
encore une lubie
elle prendra trois couleurs
peindra les grandes prairies
écrira dans son cahier
ça y va quand elle s’y met
ne met pas la tête sous l’eau
quand elle nage
—————————
les grandes prairies
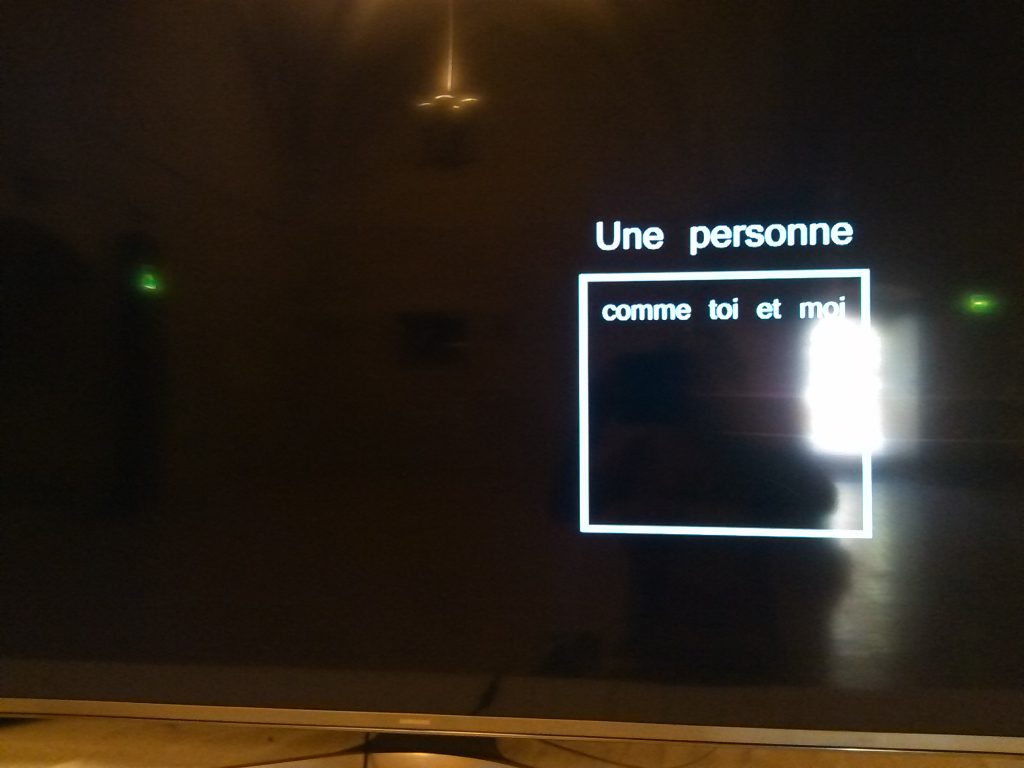
[titre de la video de Maryam Dehghanpour, abbaye de Noirlac jusqu’au 16 juillet 2017]

