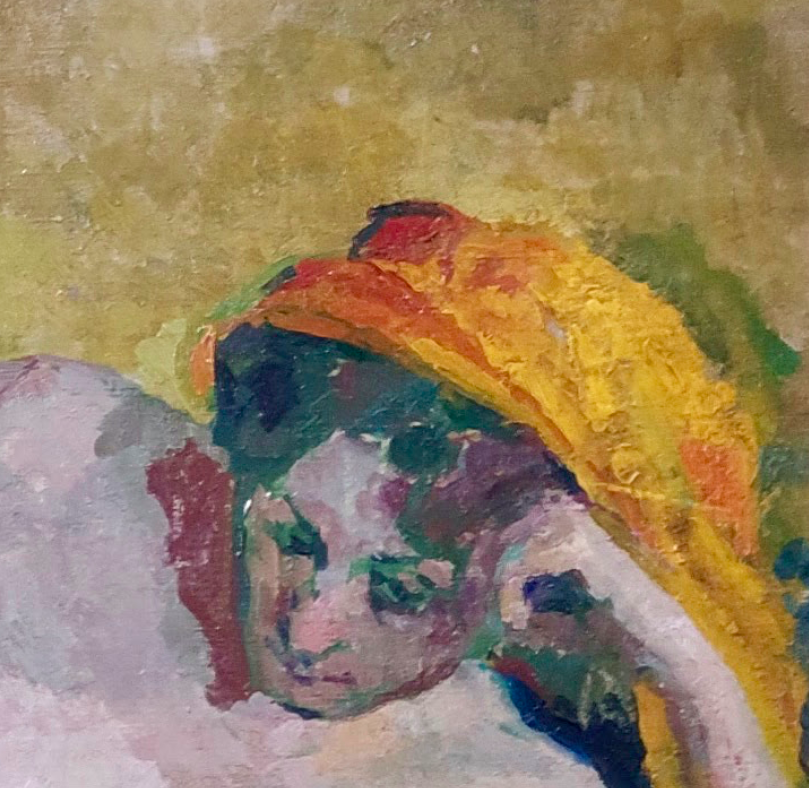Qu’est-ce qui peut être grandiloquent aujourd’hui, à la veille ou à la purée, d’une troisième guerre mondialisée, parce que maintenant c’est plus mondialisée que mondiale. Dans la purée, on y est. On peut quand même aller au cinéma s’en mettre plein les mirettes de Hollywood, et ressortir en courant dans la rue avec une impression de voler, mais on ne vole pas, enfin si, un peu.
Les vieux couples qui vont au cinéma sont des emmerdeurs au même titre que les vieux couples qui font autre chose. Mais ceux du cinéma parlent, les autres aussi, mais ceux du cinéma, parlent, et gênent en parlant, parce qu’ils parlent fort parce qu’ils entendent mal. Ils parlent, ces vieux couples au cinéma, et en plus ils disent : « Et si on allait acheter du pop-corn ? ». Et là, c’est horrible. On voudrait disparaître. Mais, coup de théâtre, parce que c’est un théâtre, ou un cinéma, on a le choix entre plusieurs salles dont une très haute, alors on monte en se disant que le vieux couple ne pourra pas monter avec ses pieds, on l’entend. Quelque part, on l’entend, ceci : « Je ne pourrai pas monter là-haut ».
Alors nous (on est un mais on fait comme si on était plusieurs), on monte très haut, pour échapper au vieux couple bavard. L’homme commente tout (parfois c’est la femme). L’homme commente tout et il semble très satisfait de lui-même et de ses commentaires. Tout ce qui est dit est parfaitement stupide, et ne sert qu’à justifier la fonction phatique du langage inventée par Jakobson, t’as qu’à regarder ce que c’est sur Google si tu sais pas.
Tu montes (tu, c’est aussi bien nous, le nous de tout à l’heure qui est un) là-haut, au plus haut, et surtout avec personne dans le dos. Les vieux couples dans le dos au cinéma, c’est le pire. Tu fais dans le radical : personne dans le dos, et c’est possible, et là, tu te calmes. Tu as trouvé ta place, au bout d’une longue quête ; tu es passé (ici, le masculin égale le neutre, pour manifester l’être humain et pas le singe par exemple) par l’étage intermédiaire, mais malheureusement à cet étage, le talisman était omniprésent.
Point sur le talisman, qu’on comprenne bien ce qui se passe : ils ont tous le talisman sorti faisant de la lumière. Tu anticipes : tu te dis qu’ils ne vont pas forcément éteindre l’objet, tellement ils ont l’air d’en avoir absolument besoin tout le temps. Or toi, tu veux juste voir le film, sans lumière, sans parole autre que celle qui vient de l’écran et des baffles sur les côtés de la salle. Donc tu montes encore. Parce que c’est possible, parce qu’il y a trois niveaux. C’est un cinéma à trois niveaux.
On a oublié une chose fondatrice qui fut dite au départ dans la salle basse du cinéma : lorsque le vieux couple arriva, la femme dit : « On vient vous tenir compagnie ». Or, on ne veut pas de compagnie. On veut la salle pour soi tout seul. D’ailleurs, on a répondu : « Si vous ne parlez pas ». Malheureusement ça n’a pas suffi. Les vieux couples bavards, il leur en faut plus pour s’arrêter de parler, c’est terrifiant. Le cinéma libèrerait-il la parole des vieux couples ? C’est idiot. Le cinéma libère la parole et le talisman lumineux de la poche. Parfois les deux en même temps. On ne sait pas pourquoi.
Enfin, en sortant, à défaut du grandiloquent introuvable impossible, on a volé un peu en courant, en disant « pardon » aux gens qui marchaient par deux et qui ne savent pas le plaisir que c’est de courir seul dans Hollywood.