Il faut se rendre à l’évidence : il y a trop de mots. Et trop de phrases.
Trop de phrases et trop d’imparfait. Trop de descriptions. Trop d’enchâssées.
Une fois que ceci est compris, alors.
Mais ceci n’est jamais compris. Ou partiellement.
Vous avez appris à ne plus rien savoir.
Je ne voulais plus me fatiguer.
Arrêtez de geindre. N’oubliez pas : le je, trop vite arrivé.
Tant pis. Aucune règle ; ébouriffons le chanvre.
Alors qu’on rêve de les voir, quatre ou cinq autour d’une table. Installés. À leur aise.
Qu’on tient à (une formule encore secrète).
A.G. avait dépassé sa station. Le bureau de B.M. était trois cent mètres en arrière.
L’imparfait, l’atroce imparfait. Exsude une immense maladresse. Triste.
Nous sommes libres, nous respirons hors l’imparfait !
Nous écoutons un continuum de clavecin aéré.
Comme mousse de framboises fouettée (ardemment fouettée).
Sonate, flûte, viole de gambe, pénétration subtile du cortex.
À chaque fois il y aura des peut-être non résolus.
À chaque fois personne ne se retournera sur la sihouette du cave.
L’invincibilité ?
Si vous voulez.
Alors ?
Alors nous n’irons plus jamais vérifier quoi que ce soit.
Vous ne feinterez plus ?
Plus jamais.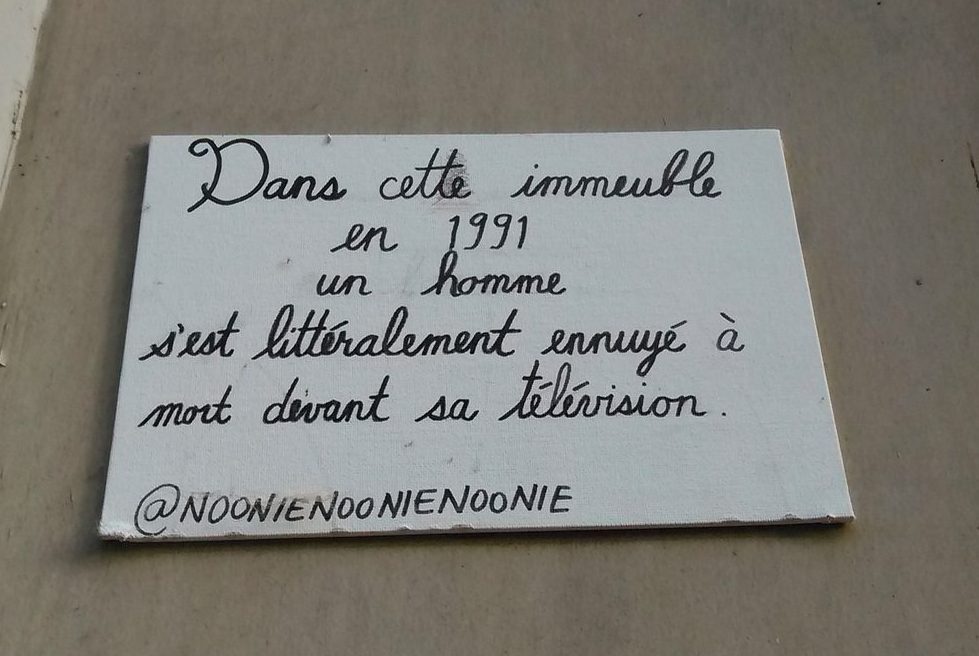
Le commun est une boue opaque.
Soyez plus clair.
Des formes en surgissent, toutes crottées d’abord.
Engels dit à Marx qu’il faut écrire un programme que tout le monde puisse comprendre.
Ils sont si jeunes. Marx doit faire vivre sa famille.
Ils l’écrivent. Ce sera le Manifeste du parti communiste.
Vous avez vérifié ?
Non.
Alors qu’on rêve de les voir, quatre ou cinq autour d’une table. Installés. À leur aise.
Qu’on tient à (une formule encore secrète).
A.G. avait souvent eu B.M. au téléphone, mais n’avait jamais été le voir.
Il est possible qu’ils se rencontrent et qu’ils fomentent un projet commun.
Qu’ils se décident à quelque chose, malgré l’odieux imparfait et tous les impossibles en travers.
(…)





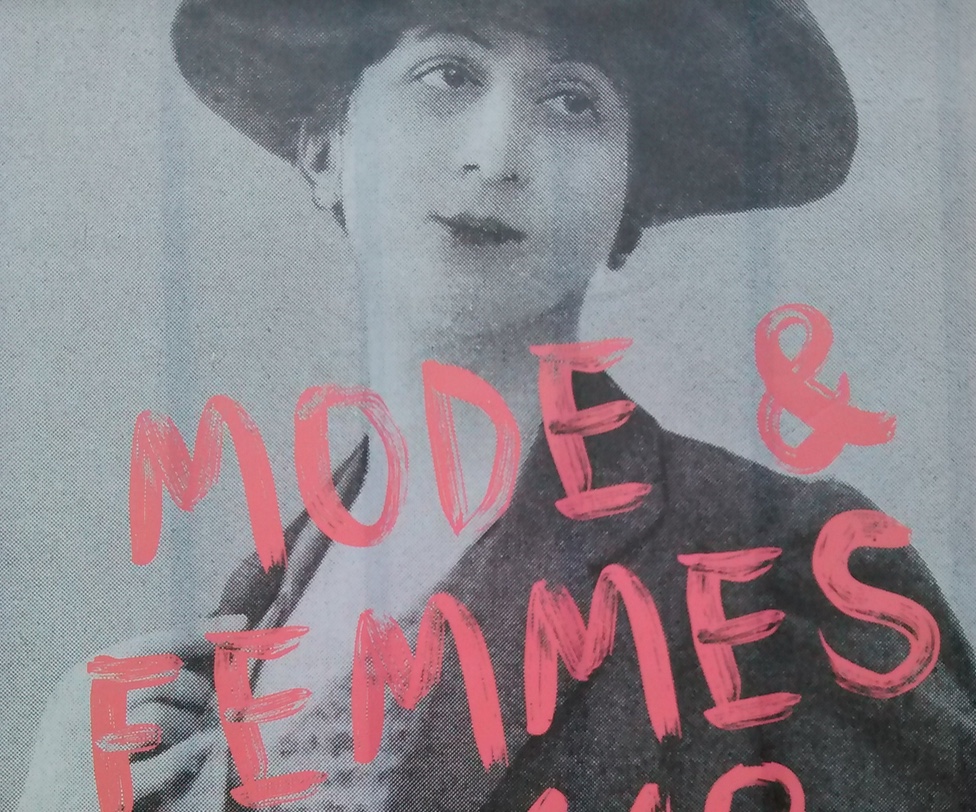 Au Tréport comme à Honfleur, à Cancale ou à Roscoff, Maud M. a cessé de se regarder nue dans les armoires à glace des vieilles chambres qui sentent la pomme normande. Elle enfile, sans aucune conscience de ses membres, peau, chairs, ses vêtements les uns derrière les autres, de sorte qu'ils la réchauffent.
Maud M. se repose sur un des bancs de pierre longeant la mer, disposés à équidistance sur une sorte de large corridor pavé de dalles de béton saumonées. Devant elle, la mer la reconstitue, elle la prend, s'enroule en elle comme dans une couverture de survie.
Elle débarque son surplus de paroles aux cormorans, tenez. Il fait gris, c'est la toile de fond sur lequel elle peut se découper sans gêner personne, replier ses jambes contre elle se disant qu'elle a froid, se disant que c'est trop mais n'en pouvant pas moins.
Son regard se remet dans l'axe de la mer, et peu à peu son esprit se calme, elle arrive à isoler le bruit du ressac des autres bruits, humains et issus de l'activité humaine. Et des mouettes aux cris impérieux. Voir la mer quelques instants et revenir. Une fois devant, Maud M. est rituellement déçue. La mer ne dit rien de plus que ce qu'elle est. La mer ne dit rien, elle est. Et être devant ne s'apprécie que d'une présence ténue, ou fugitive, un peu comme une guimauve : beaucoup de promesses mais peu de consistance.
Des avions, blancs, traversent le ciel, bleu, et ainsi chaque jour, de nombreux avions emmènent de nombreuses personnes loin, dont le regard de Maud M. suit distraitement la trajectoire. Elle se tait.
Elle attend ce qu'elle ne sait pas. Sur son banc, figée. Ce que la mer lui renvoie, un mur ou un miroir, un mur et un miroir, l'attend encore. La mer : miroir ou mur. Réfléchit, miroir. Regarde la mer : mur.
Malgré les galets sur lesquels elle se tord les pieds, Maud M. s'est décidée à marcher le long de la plage. Des cueilleurs de coquillages en couleurs vives officient. C'est marée basse.
Marcher, c'est encore quelque chose qu'elle murmure, elle accompagne marcher de parler, sa parole sort avec le bruit du ressac. Il fait froid, elle s'enhardit, elle grogne, elle profère des morceaux de mots, des bouts, que l'air plein d'iode gifle, elle ne sait pas si c'est de l'iode, l'iode est ce qu'elle a lu, elle respire ce qu'elle a lu, des pages et des pages de bouts de mots.
Oui, redit-elle dans un sursaut, et elle shoote dans une coque d'oursin on dirait. Maud M. ne perd pas la raison, la raison n'existe plus, elle s'en débarrasse comme de la chair orangée de l'oursin, elle la crache, la raison.
Au Tréport comme à Honfleur, à Cancale ou à Roscoff, Maud M. a cessé de se regarder nue dans les armoires à glace des vieilles chambres qui sentent la pomme normande. Elle enfile, sans aucune conscience de ses membres, peau, chairs, ses vêtements les uns derrière les autres, de sorte qu'ils la réchauffent.
Maud M. se repose sur un des bancs de pierre longeant la mer, disposés à équidistance sur une sorte de large corridor pavé de dalles de béton saumonées. Devant elle, la mer la reconstitue, elle la prend, s'enroule en elle comme dans une couverture de survie.
Elle débarque son surplus de paroles aux cormorans, tenez. Il fait gris, c'est la toile de fond sur lequel elle peut se découper sans gêner personne, replier ses jambes contre elle se disant qu'elle a froid, se disant que c'est trop mais n'en pouvant pas moins.
Son regard se remet dans l'axe de la mer, et peu à peu son esprit se calme, elle arrive à isoler le bruit du ressac des autres bruits, humains et issus de l'activité humaine. Et des mouettes aux cris impérieux. Voir la mer quelques instants et revenir. Une fois devant, Maud M. est rituellement déçue. La mer ne dit rien de plus que ce qu'elle est. La mer ne dit rien, elle est. Et être devant ne s'apprécie que d'une présence ténue, ou fugitive, un peu comme une guimauve : beaucoup de promesses mais peu de consistance.
Des avions, blancs, traversent le ciel, bleu, et ainsi chaque jour, de nombreux avions emmènent de nombreuses personnes loin, dont le regard de Maud M. suit distraitement la trajectoire. Elle se tait.
Elle attend ce qu'elle ne sait pas. Sur son banc, figée. Ce que la mer lui renvoie, un mur ou un miroir, un mur et un miroir, l'attend encore. La mer : miroir ou mur. Réfléchit, miroir. Regarde la mer : mur.
Malgré les galets sur lesquels elle se tord les pieds, Maud M. s'est décidée à marcher le long de la plage. Des cueilleurs de coquillages en couleurs vives officient. C'est marée basse.
Marcher, c'est encore quelque chose qu'elle murmure, elle accompagne marcher de parler, sa parole sort avec le bruit du ressac. Il fait froid, elle s'enhardit, elle grogne, elle profère des morceaux de mots, des bouts, que l'air plein d'iode gifle, elle ne sait pas si c'est de l'iode, l'iode est ce qu'elle a lu, elle respire ce qu'elle a lu, des pages et des pages de bouts de mots.
Oui, redit-elle dans un sursaut, et elle shoote dans une coque d'oursin on dirait. Maud M. ne perd pas la raison, la raison n'existe plus, elle s'en débarrasse comme de la chair orangée de l'oursin, elle la crache, la raison.
 L'idée qu'elle a du bleu de l'azur est un bleu de littérature, comme les travailleurs avaient des bleus de chauffe. Elle se déplace au jugé, rien n'est resté, elle nage dans les mots, une mer de mots. Et parfois, aucun d'eux ne saille comme une queue de requin, aucun.
*
Beaucoup plus tard, Maud M. recevra un SMS mystérieux : Mettez un costume rouge, vous êtes plus que nu, vous êtes un objet pur, sans intériorité *. Elle ne répond pas, ça n'appelle pas de réponse. Une pensée démodée, parfois un peu surprenante, comme cette phrase ; et vraie.
L'anse devant laquelle elle s'est arrêtée, en suivant la côte, sur l'un de ces petits parkings qui indiquent le point de vue avec un œil aguicheur étoilé de noirs traits gras, profile une orbite abrupte et brune en haut de laquelle elle a laissé traîner sa pensée bien au-delà de ce qu'elle eût voulu.
L'idée qu'elle a du bleu de l'azur est un bleu de littérature, comme les travailleurs avaient des bleus de chauffe. Elle se déplace au jugé, rien n'est resté, elle nage dans les mots, une mer de mots. Et parfois, aucun d'eux ne saille comme une queue de requin, aucun.
*
Beaucoup plus tard, Maud M. recevra un SMS mystérieux : Mettez un costume rouge, vous êtes plus que nu, vous êtes un objet pur, sans intériorité *. Elle ne répond pas, ça n'appelle pas de réponse. Une pensée démodée, parfois un peu surprenante, comme cette phrase ; et vraie.
L'anse devant laquelle elle s'est arrêtée, en suivant la côte, sur l'un de ces petits parkings qui indiquent le point de vue avec un œil aguicheur étoilé de noirs traits gras, profile une orbite abrupte et brune en haut de laquelle elle a laissé traîner sa pensée bien au-delà de ce qu'elle eût voulu.