intercalage est moins employé
c’est une remarque qui me l’apprend
REM. Intercalage, subst. masc., rare. Action d’intercaler, d’insérer quelque chose ; résultat de l’action. Il n’y a pas eu non plus intercalage brusque d’un élément opaque qui aurait séparé l’antérieur du postérieur comme une lame de couteau sépare un fruit en deux (Sartre, Être et Néant, 1943, p. 61).
je m’occupe du sens B à propos de quelque chose que je suis tentée de faire pour ne plus assister à la défaite d’un texte que j’écris/n’écris pas
B − Ajout à l’intérieur d’un ensemble terminé. L’intercalation d’un mot, d’une ligne dans un acte, d’un article dans un compte, d’un passage dans un texte (Ac. 1835-1935).
j’intercale alors dans ce texte des mots en corps plus petit, comme
totalement cru,
général,
bizarre,
ces mots ne pouvant que faiblement faire état d’une continuité non plus que d’un sens très précis
pour parfaire mon émulation j’ajoute l’exemple proposé par métonymie que je suis obligée de relire une dizaine de fois et auquel je ne comprends toujours rien
Par méton. : Je vous envoie une intercalation, la pièce Tu peux comme il te plaît me faire jeune ou vieux, qui entre dans le livre II sous le numéro VIII et rejette au chiffre IX la pièce En écoutant les oiseaux. Modifier les chiffres d’ordre suivants en conséquence. Hugo, Corresp.,1855, p. 211.
puis je regarde les tiroirs de mon bureau, au nombre de huit, deux fois quatre, encadrant un double espace horizontal délimité par une étagère dont j’ignore si elle peut être définie par son intercalation, que je prononce alors mentalement
Prononc. et Orth. : [ε ̃tε ʀkalasjɔ ̃]. Att. ds Ac. dep. 1694.
les mots se dérobent et flottent dans une temporalité devenue incertaine, que le sens A me confirme avec la possibilité d’un treizième mois ajouté aux douze autres
A − CHRONOLOGIE. Addition périodique de jours à l’année civile afin de la faire coïncider avec l’année astronomique. Pour établir l’accord entre les mois lunaires et l’année solaire, les Grecs eurent recours, comme nous l’avons déjà vu chez d’autres peuples, à l’intercalation d’un treizième mois, ce qui donna des années de 354 ou 355 jours et d’autres de 383 ou 384 jours (Chauve-Bertrand, Question calendrier,1920, p. 54).
rien d’étonnant alors si la véritable nature de l’intercalation se révèle dans le bordel du monde tel que défini par le sens C
C − Introduction, insertion de quelque chose dans un ensemble ; fait que quelque chose apparaisse comme inséré dans un ensemble de nature ou d’aspect différent. Dans ces caillasses apparaissent tantôt des lits d’eau douce, tantôt des intercalations gypseuses, attestant l’évaporation qui se faisait dans les lagunes parisiennes (Lapparent, Abr. géol.,1886, p. 345). La répartition des terres et des mers, l’intercalation des plaines et des montagnes (Vidal de La Bl., Princ. géogr. hum.,1921, p. 214). [J’] insère des projets secondaires dans des projets primaires par truffage graduel ou intercalation (Ricœur, Philos. volonté, 1949, p. 48).
[merci au CNRTL]




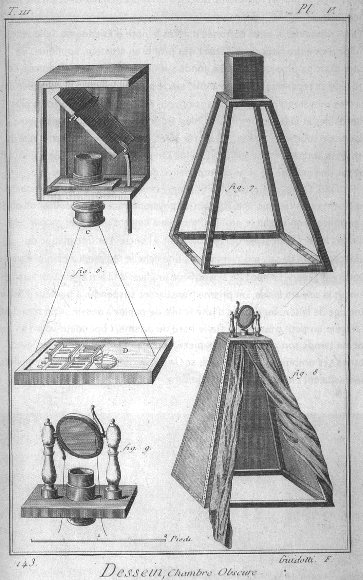 il y a des références, des sentences,
il y a des références, des sentences,