quelqu’un d’autre
puis quelqu’un d’autre
puis quelqu’un d’autre
a été
sera
fut
inégalée
l’apparition
sur une scène
cimes dispersées
dans la plaine
au loin
p
e
r
l
e
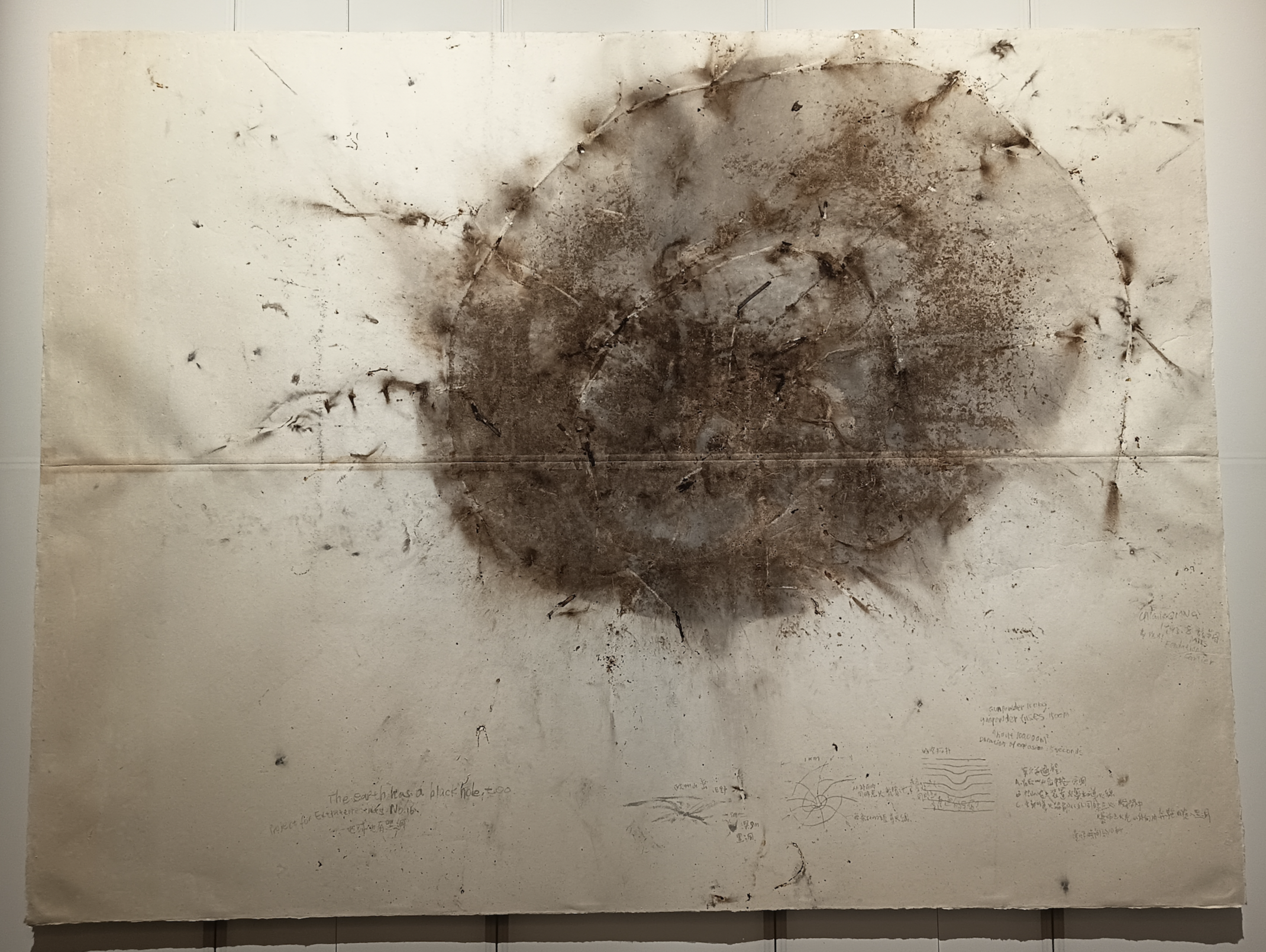
écrire et ne pas écrire : ce mouvement
quelqu’un d’autre
puis quelqu’un d’autre
puis quelqu’un d’autre
a été
sera
fut
inégalée
l’apparition
sur une scène
cimes dispersées
dans la plaine
au loin
p
e
r
l
e
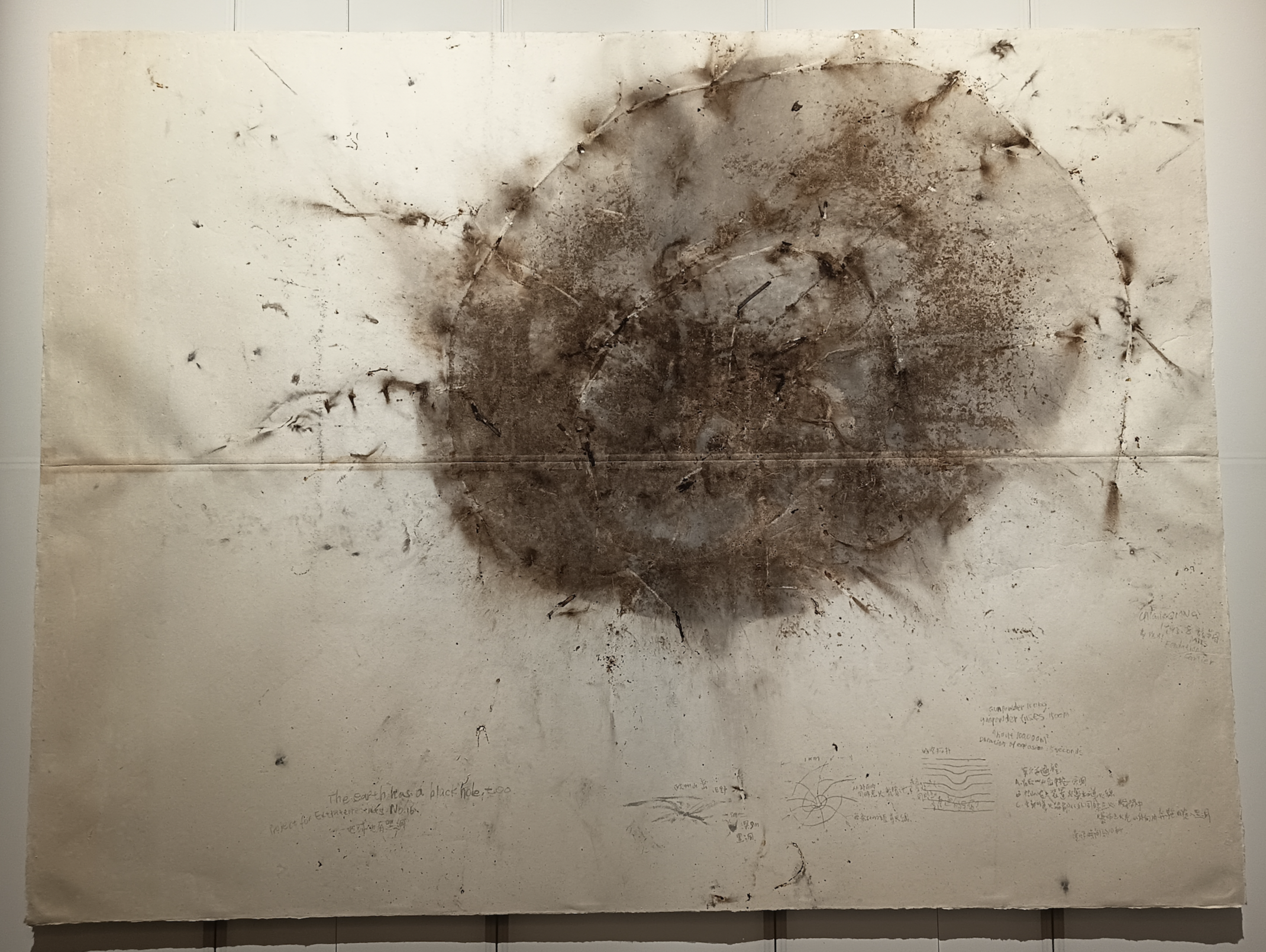
commençons par la fin du symptôme
carnet ouvert à plat sur table basse
carnet jaune et blanc dos scotché
étiquette mentionnant deux dates
entre deux années,
d’une durée d’environ dix-huit mois,
commençons par ce petit carnet
à petits carreaux zébré de couleurs vives
la fin du symptôme est datée de douze
de septembre douze
et avec, une question :
”que voulez-vous faire ?”
ou plus exactement et moins élégamment
”qu’est-ce que vous voulez faire ?”
Le ciel est à tout le monde
est un magasin de jouets de son enfance ;
il fallait bien que quelque chose changeât,
que dans le décor la peinture s’écaillât
que des cris cessassent de résonner
que des objets changeassent de mains
que des livres s’écornassent
et puis, lassée des jeux de langue
des constructions verbales
des concordances de temps
gavées de crème et de meringue,
soudain la pavlova du ”tout ça” fondrait
au caniveau du temps perdu
& en violet s’écrirait :
je peux comprendre les vieillards
sur le banc d’un quartier
qu’ils n’ont jamais quitté
commençons par la fin du symptôme
et le principe de la répétition
commençons par les spires de l’escargot
et sa course lente dans l’allée
commençons par le tournage en rond
commençons par ne rien commencer
commençons par changer de page
commençons par ne rien changer
laissons le carnet ouvert à plat
& le ”tout ça” naviguer à l’envers…

quand ça insiste noter
même si ne pas trouver un titre
adresse titre
fichier notes pour un titre
notes pour l’abîme
notes à dégringoler le sens
notes folâtres
et folâtrer pleurer
dans un impossible giron
ricaner l’aube sans couleur
s’exclamer quoi !
quoi encore !
quand ça insiste un titre le trouver
ou jamais
même le mot [giron]
se soustrait j’irons aussi bien
dans les bois fomenter
l’attentat ultime dans l’odeur
littéraire des feuilles mortes
ah et la voix
l’encor voix à qui
disque rayé & falbalas décor
commment t’appelles-tu déjà ?
un titre disais-tu ?
j’entends mal
tu peux répéter ?
(…)

j’ai expérimenté le chou-fleur qui fait peur,
j’en ai fait une effilochée au curry + huile d’olive sel poivre /
je savais pas quoi en faire,
je pensais le jeter mais pas : guerre en Ukraine ça craint –
pas : on jette pas –
une fois recuit, réduit par le presse-purée entre parenthèses ça fabrique du jus et l’effilochée reste au dessus dans la tourniquette bref le bordel
cuisson : d’abord rien d’abord congelé en entier tout entier
ensuite cuit tout entier tout congelé crispé dans une marmite
ensuite jamais cuit jamais
ensuite ça pue ça pue ça pue trop ça pue tant et tant
gênée je le remets au frais une fois froid
ça pue quand même au frigo
je le couvre avec un film
une fois filmé je sais toujours pas quoi en faire
très fort je pense le jeter j’en parle à la voisine
guerre en Ukraine pas jeter le chou-fleur
elle me donne des pommes on sort les poubelles
il me fait peur le chou-fleur quand je le sors du frigo
je peux pas le jeter
je cherche sur internet je vois purée de chou-fleur au curry
je le recuis en le découpant mais c’est pas un poulet
je le recuis mais il cuit pas
il cuit jamais j’ai peur du chou-fleur même en bouquets
j’en ai marre j’éteins sous le chou-fleur je pense à autre chose
plus tard je reviens je fabrique l’effilochée telle que décrit plus haut
j’en prélève un peu je saupoudre de curry je verse l’huile d’olive
je sale je poivre d’Indonésie
encore tiède dans un bol blanc
dans un autre bol blanc je mange une banane au calva
& j’entends Philippe Katerine des bisous des bisous des bisous
je ne veux plus jamais travailler plutôt crever
non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage

il n’y aura que des flots faux
tes impressions avec des mots
on s’en fout
auras beau te tenir à l’orée
des fleuves et des clairières
on s’en fout
n’y aura que des flots faux
des petits machins cyniques
du tu disparu
des signaux faibles
ému des souvenirs
à balancer aux lions inexistants
qui a déjà vu un lion ?

Musée Guimet, Paris
un calme règne
une lumière blanche étrange
de ces jours sans nom
jours indifférents
exister dans les interstices
un calme règne
d’un autre jour
sa lumière bleutée douce
des questions l’horizon
des réponses l’absence
